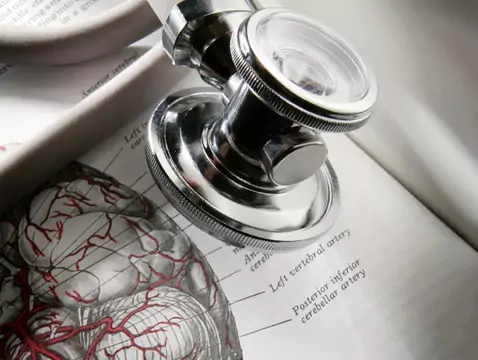La résistance aux médicaments est un problème croissant dans la médecine moderne. Elle touche pratiquement toutes les disciplines cliniques, bien qu'elle soit le plus souvent mentionnée dans le traitement des infections et la thérapie anticancéreuse. En neurologie, l'un des problèmes actuels est l'épilepsie pharmacorésistante. Grâce aux progrès de la science fondamentale, de nouveaux médicaments permettant de surmonter le mécanisme de la multirésistance aux médicaments pourraient bientôt entrer en clinique.
Publicité: